"Ce n'est pas la recherche du bonheur qui est le grand mobile des actions des hommes, mais le souhait inhérent à chacun de ses actes : Ne pas être celui que je suis."
Et c'est loin d'être faux...
Ce n'est pas de moi (moi je suis loin de cette qualité d'aphorimses limpides, c'est de Fabrice Melquiot, l'auteur de Percolateur Blues, pièce que je vous engage à voir dès que possible aux Déchargeurs... Parce que la mise en scène, les textes, les acteurs et même la musique... bref, c'est assez génial...)
Toujours est-il que pour l’auteur du jour, cela convient plutôt bien : Cercas est l’auteur, et /ou l’habile narrateur de ce roman où se mêlent intelligemment son histoire vécue, son histoire fantasmée et celle imaginée par le lecteur… sa fuite, celle de son héros et la rédemption que jamais z’il ne trouvit… même au bout de la 288ème page.
Tel un Œdipe moderne, chargé du poids du succès qu’il lui sait impossible de ne pas chercher, l’écrivain subira les conséquences d’un destin que tous pourraient croire enviable et heureux. Perdu, le succès, c’est la mort.
Et le Vietnam de Cercas, c’est de devoir vivre après son roman best seller, les Soldats des Salamides…
Et c'est loin d'être faux...
Ce n'est pas de moi (moi je suis loin de cette qualité d'aphorimses limpides, c'est de Fabrice Melquiot, l'auteur de Percolateur Blues, pièce que je vous engage à voir dès que possible aux Déchargeurs... Parce que la mise en scène, les textes, les acteurs et même la musique... bref, c'est assez génial...)
Toujours est-il que pour l’auteur du jour, cela convient plutôt bien : Cercas est l’auteur, et /ou l’habile narrateur de ce roman où se mêlent intelligemment son histoire vécue, son histoire fantasmée et celle imaginée par le lecteur… sa fuite, celle de son héros et la rédemption que jamais z’il ne trouvit… même au bout de la 288ème page.
Tel un Œdipe moderne, chargé du poids du succès qu’il lui sait impossible de ne pas chercher, l’écrivain subira les conséquences d’un destin que tous pourraient croire enviable et heureux. Perdu, le succès, c’est la mort.
Et le Vietnam de Cercas, c’est de devoir vivre après son roman best seller, les Soldats des Salamides…
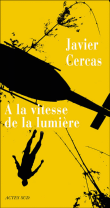
Javier CERCAS
A la Vitesse de la lumière
Actes Sud
Traduit de l' espagnol
par Aleksandar Grujicic
et Elisabeth Beyer
288 pages/21€
l’éditeur raconte…
Dans une université américaine, un écrivain débutant, qui pourrait s'appeler Cerças (j'adore!), se lie d'amitié avec un vétéran du Vietnam anéanti par le poids de son passé.
A son retour en Espagne, le succès de l'un de ses romans le propulse soudain au firmament et, gorgé de suffisance, il ne sait pas voir qu'il a perdu son âme. Un drame se produit auquel, peut-être, il faudrait survivre. Aux portes de l'enfer, qui s'ouvrent béantes sur le mépris de soi et le désir de mort, il unit son destin à celui de l'ami américain. Dans une impunité souveraine, l'un a ressenti la jouissance de tuer sans raison, l'autre a connu le vertige d'abuser de son piètre pouvoir. A la vitesse de la lumière, ils se sont pris pour des dieux pour se retrouver, brisés, dans ce sentiment archaïque et latent qu'est la culpabilité.
C’est plus premier degrés que cela, tout au moins au début : la rencontre d’un étudiant un peu paumé avec un vrai accidenté de la vie, Rodney. On apprend peu à peu, on fait tomber les préjugés du jeune écrivaillon à commencer ceux qu’il possède sur son propre pays. Le premier tiers du livre est très Erasmus des années 80. L’isolement de la petit citée américaine aidant. Puis au fur et à mesure, on s’intéresse à Rodney. On découvre comme lui que le passé ne s’oublie pas, que l’horreur est humaine… Mais toujours et c’est important, sans rien dire. Il ne s’agit que de regards, d’allusions, de discours brefs à mots couverts. La deuxième partie du roman est espagnole, retour sur le présent, puis le cheminement qui a amené Cercas au succès, entre la nostalgie, l’interrogation, le refus. C’est très bien fait, et surtout pas prétentieux ou timoré. Puis la fin du roman, qui vous cueille comme un fruit mûr, où toutes les explications tombent, où tous les personnages font le travail de mise à plat, et dressent les comptes de résultat.
Un très bon roman, justement de par ce jeu de la fiction rendue réelle, de la thérapie qu’on devine semi fantasmée, mais aussi et surtout par le ton, intelligent, et le texte, espagnol pur jus. C’est idiot, mais je n’avais pas lu de roman hispanophone depuis fort longtemps et j’ai redécouvert cette construction de phrase avec plaisir (car la traduction est menée avec assez de talent pour rendre respirable la tonalité originale du livre).
Bref, c’est ma claque de la semaine dernière…
Dans une université américaine, un écrivain débutant, qui pourrait s'appeler Cerças (j'adore!), se lie d'amitié avec un vétéran du Vietnam anéanti par le poids de son passé.
A son retour en Espagne, le succès de l'un de ses romans le propulse soudain au firmament et, gorgé de suffisance, il ne sait pas voir qu'il a perdu son âme. Un drame se produit auquel, peut-être, il faudrait survivre. Aux portes de l'enfer, qui s'ouvrent béantes sur le mépris de soi et le désir de mort, il unit son destin à celui de l'ami américain. Dans une impunité souveraine, l'un a ressenti la jouissance de tuer sans raison, l'autre a connu le vertige d'abuser de son piètre pouvoir. A la vitesse de la lumière, ils se sont pris pour des dieux pour se retrouver, brisés, dans ce sentiment archaïque et latent qu'est la culpabilité.
C’est plus premier degrés que cela, tout au moins au début : la rencontre d’un étudiant un peu paumé avec un vrai accidenté de la vie, Rodney. On apprend peu à peu, on fait tomber les préjugés du jeune écrivaillon à commencer ceux qu’il possède sur son propre pays. Le premier tiers du livre est très Erasmus des années 80. L’isolement de la petit citée américaine aidant. Puis au fur et à mesure, on s’intéresse à Rodney. On découvre comme lui que le passé ne s’oublie pas, que l’horreur est humaine… Mais toujours et c’est important, sans rien dire. Il ne s’agit que de regards, d’allusions, de discours brefs à mots couverts. La deuxième partie du roman est espagnole, retour sur le présent, puis le cheminement qui a amené Cercas au succès, entre la nostalgie, l’interrogation, le refus. C’est très bien fait, et surtout pas prétentieux ou timoré. Puis la fin du roman, qui vous cueille comme un fruit mûr, où toutes les explications tombent, où tous les personnages font le travail de mise à plat, et dressent les comptes de résultat.
Un très bon roman, justement de par ce jeu de la fiction rendue réelle, de la thérapie qu’on devine semi fantasmée, mais aussi et surtout par le ton, intelligent, et le texte, espagnol pur jus. C’est idiot, mais je n’avais pas lu de roman hispanophone depuis fort longtemps et j’ai redécouvert cette construction de phrase avec plaisir (car la traduction est menée avec assez de talent pour rendre respirable la tonalité originale du livre).
Bref, c’est ma claque de la semaine dernière…
Extraits :
Le temps a passé. Je commençais à oublier Urbana. En revanche, je n'ai pas pu oublier (ou pas tout à fait) les amis d'Urbana, surtout parce que, de temps à autre et sans que j'y sois pour rien, ils continuaient à me donner de leurs nouvelles. Le seul qui était encore à Urbana était John Borgheson, que j'ai revu à plusieurs reprises lors de ses rares visites à Barcelone et dont l'allure professorale me paraissait chaque fois plus vénérable et plus britannique. Felipe Vieri avait terminé ses études à l'université de New York, où il avait réussi à décrocher un poste de professeur, et vivait à Greenwich Village, ayant réalisé son rêve de toujours : être un New-Yorkais jusqu'au bout des ongles. La vie de Lura Burns était plus turbulente et variée : elle avait terminée son doctorat à Urbana, s'était mariée avec un ingénieur informaticien de Hawaii, avait divorcé et, après être passée par différentes universités de la côte ouest, avait atterri à Oklahoma City où elle s'était remariée, cette fois avec un homme d'affaires qui lui avait fait quitter son travail et l'obligeait à vivre à cheval entre Oklahoma et Mexico.
Chapitre : La porte en pierre - Page : 139 -
Mais tandis que je m'approchais de Rodney tout en dépassant l'extrémité d'une baie qui m'empêchait d'avoir une vision complète du gazon, je me suis rendu compte que mon ami n'était pas en train de prendre un bain de soleil mais de contempler un groupe d'enfants qui jouaient devant lui. [... ]. Et alors que je traversais la rue pour aller saluer Rodney, je me suis arrêté. Je ne sais pas avec certitude pourquoi mais je crois que la raison en était que j'avais noté quelque chose de bizarre chez mon ami, quelque chose qui m'avait paru dissuasif ou peut-être de menaçant, comme une certaine rigidité dans sa posture, une tension douloureuse, presque insupportable, dans sa façon d'être assis et de regarder les enfants jouer.
Chapitre : Tous les chemins - Page : 45 -
Je vous engage à lire la critique des Inrocks, qui fait une belle double page et qui pour une fois est tres bien ficellée. Ainsi que celle de Chronic’art, que pour le coup, je vous ai mis là. Achetez ce livre. Ou écrivez moi et je vous l’offre.
la note de Chronic'art d'Eric Fouquet
1 commentaire:
"Le premier tiers du livre est très Erasmus des années 80". Ah bon, curieuse de lire ça:)
Enregistrer un commentaire